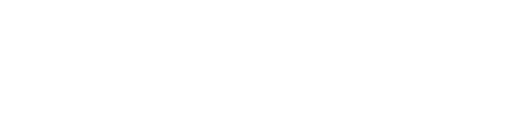Pékin – Les mégapoles d’aujourd’hui ne sedéfinissent plus seulement par leurs gratte-ciels et leurs flux de population, mais par la manière dont elles organisent l’accès à leurs réseaux : énergie, mobilité, données. Dans la capitale chinoise, où les défis urbains se comptent en millions de trajets quotidiens, en pics de pollution et en besoins énergétiques colossaux, la ville intelligente prend forme à travers une question centrale : comment fixer le prix de ses services pour garantir à la fois efficacité et qualité de vie citadine.
Cettequestion, en apparence technique, plonge ses racines dans la pensée d’économistes qui ont marqué la théorie des réseaux. Dans les années 1950, Marcel Boiteux formulait la tarification dite de Ramsey-Boiteux, selon laquelle les prix doivent refléter non seulement les coûts marginaux mais aussi la capacité des usagers à y répondre. Autrement dit, demander plus à ceux qui peuvent supporter un tarif élevé afin de préserver l’accès aux services essentiels pour les autres. Pékin applique cette logique dans son organisation énergétique et dans son chauffage urbain, où l’équilibre entre rentabilité des infrastructures et accessibilité quotidienne devient un outil concret d’aménagement de la ville.
À une autreéchelle, les travaux de Jean Tirole et de ses collègues Jean-Charles Rochet et
Mark Armstrong ont redéfini la manière dont les réseaux modernes fonctionnent. Ils ont montré que, dans les industries où se croisent usagers et fournisseurs, il existe des logiques de plateformes bifaces : un côté peut être subventionné, l’autre supportant le financement. Cette intuition s’observe dans le numérique urbain de Pékin, où certaines applications et solutions technologiques sont accessibles gratuitement aux habitants, financées par des partenariats privés et la valorisation des données. La gratuité apparente devient ainsi un instrument de fluidité, une façon de rapprocher les citoyens des services de la ville sans accroître leurs charges. Comme l’écrit Jean Tirole dans Économiedu bien commun (2016) : « La régulation n’est pas l’ennemie du marché ;elle en est la condition d’existence dans un monde où les externalités et les asymétries d’information sont omniprésentes. »
Mais une métropole comme Pékin ne peut ignorer la question des flux, des embouteillages et des congestions qui paralysent ses artères. Les enseignements de William Baumol et David Bradford trouvent ici leur traduction : la tarification doit tenir compte de la congestion. Dans les transports, cette idée se traduit par une modulation des coûts selon les périodes d’affluence, incitant à répartir les usages, à fluidifier les déplacements et à réduire les pics de saturation. Le prix n’est plus seulement un moyen de recouvrer un coût, mais devient un instrument d’organisation urbaine.
Or, Pékin nese limite pas à l’abstraction théorique. La ville a mené en 2019 une étude de simulation sur la tarification de congestion dans la zone de la 4ᵉ ceinture, testant différents niveaux de prix et périmètres afin d’évaluer leur effet sur le trafic urbain. Les chercheurs ont montré que la tarification pouvait réduire significativement les embouteillages tout en améliorant la fluidité et la qualité de vie des habitants (Dai Jingchen & Li Ruimin, 2019). Dans un autre domaine, une équipe a proposé dès 2017 un modèle d’optimisation pour la tarification des bornes de recharge de véhicules électriques, afin d’intégrer les coûts environnementaux et la pression sur le réseau électrique (Zhang et al., 2017).
Plus récemment, des évaluations des politiques tarifaires de Pékin – qu’il s’agisse des frais de stationnement, des prix des transports publics ou de la fiscalité sur les carburants – ont confirmé leur efficacité dans la réduction des émissions de carbone et de la congestion urbaine (MDPI, 2021). Ces mesures montrent que la tarification n’est pas seulement une question financière, mais bien un outil central de gouvernance urbaine.
Pris dansleur ensemble, ces modèles théoriques composent une grammaire économique que Pékin tente de mettre en musique pour façonner une Smart City singulière. L’enjeu n’est pas seulement de rentabiliser des infrastructures massives, mais de créer un cadre où l’accès à l’énergie, à la mobilité et aux services numériques s’inscrit dans une logique d’amélioration de la qualité de vie citadine. La technologie et l’algorithmique fournissent les outils, mais ce sont les modèles hérités de Boiteux, Tirole ou Baumol qui donnent le langage économique à cette ambition.
Ainsi,derrière chaque compteur connecté, chaque tarification dynamique, chaque plateforme numérique gratuite pour l’usager, se dessine une vision : celle d’une ville où l’intelligence ne réside pas seulement dans ses réseaux, mais dans sa capacité à concilier efficacité et quotidien urbain. Pékin, à travers ses expérimentations, illustre que la Smart City n’est pas uniquement un horizon technologique, mais aussi une construction économique et sociale, où la gestion des prix devient un levier central d’une vie citadine plus fluide et plus équilibrée.
Références principales
Marcel Boiteux (1956). “Sur la gestion des monopoles publics astreints à l’équilibre budgétaire.” Econometrica, vol. 24, no. 1.
Jean-Charles Rochet & Jean Tirole (2003). “Platform competition in two-sided markets.” Journal of the European Economic Association, 1(4), 990–1029.
Jean Tirole (2016). Économie du bien commun. Paris : PUF.
William J. Baumol & David F. Bradford (1970). “Optimal Departures from Marginal Cost Pricing.” American Economic Review, vol. 60, no. 3.
Références appliquées à Pékin
Dai Jingchen & Li Ruimin (2019). Microscopic Simulation Based Evaluation of Congestion Pricing for Beijing Urban Area. China Simulation Journal.
Zhang, Liang, Zhang, Bu, Zhang (2017). “Charge Pricing Optimization Model for Private Charging Piles in Beijing.” Sustainability, MDPI.
ScienceDirect (2021). “Reducing energy consumption and pollution in the urban transportation sector: A review of policies and regulations in Beijing.” Journal of Cleaner Production.
MDPI (2022). “Performance Evaluation of Fee-Charging Policies to Reduce the Carbon Emissions of Urban Transportation in China.” Atmosphere.